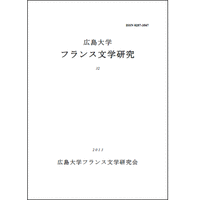
この文献の参照には次のURLをご利用ください : https://doi.org/10.15027/19767
広島大学フランス文学研究 24 号
2005-12-25 発行
フランスの言語と文化 : 古典文学, 1789年, フランス(語)の教育
La littérature « classique », 1789 et l'enseignement du français en France
末松 壽
Abstract
C'est à la Révolution française qu'on s'est rendu compte d'une étrange situation linguistique du pays : malgré la gloire de l' « universalité » européenne de la langue, plusieurs millions de Français (un huitième des Français, dit Roland, au moins six millions, assure l'abbé Grégoire) , n'étaient pas en fait « francophones », surtout dans les campagnes. Y étaient vivants et vivaces « trente patois », parmi lesquels l'abbé mettait pêle-mêle dialectes « corrompus » du français et idiomes tels l'allemand, le basque, le breton, le flamand, l'italien... eux-mêmes plus ou moins « dégénérés », comme on le disait. Après la tentative échouée de diffusion de textes politico-juridiques traduits dans quelques-uns de ces patois, les révolutionnaires décident finalement la création d'une éducation publique et nationale, qui débuta en effet le 30 vendémiaire an II (21 octobre 1793) par un décret instituant des écoles primaires d'Etat, qui mettait la langue française, comme cela se devait, au centre de l'enseignement primaire. Cette petite étude, après avoir brièvement retracé l'historique de l'enseignement en France, en s'appuyant sur le grand livre de F. Brunot, essaie d'observer, à travers des textes officiels édités par A. Chervel, quelle place de poids finira par occuper la littérature française classique dans l'éducation publique qui s'élabore en deux siècles. Par là l'auteur explique d'une part la raison pour laquelle les romantiques, épris d'originalité, se sont insurgés contre elle et ont taxé de « classique » (imitation des littératures gréco-latines) ce produit essentiellement élitiste du règne de Louis XIV, et pourtant - curieux paradoxe - « officialisé » par le nouveau régime en tant que la littérature « nationale », et de l'autre la cause du maintien de la continuité ou de l'identité relativement solide du français (comparé par exemple au japonais moderne) depuis ces trois ou quatre siècles.
About This Article
Other Article
PP. 203 - 218
PP. 309 - 313
PP. 327 - 332