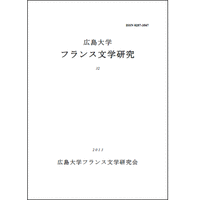
この文献の参照には次のURLをご利用ください : https://doi.org/10.15027/32213
広島大学フランス文学研究 30 号
2011-12-25 発行
レーモン・クノー『イカロスの飛行』 : 空中のメタフィクション
Le Vol d'Icare de Raymond Queneau : ou la métafiction ailée
原野 葉子
Abstract
Le Vol d'Icare (1968), le dernier roman de Raymond Queneau, se caractérise par une légèreté flottante qui émane systématiquement des jeux de logique, de la distanciation burlesque et de la vision pluridimensionnelle du survol légendaire.
Dans cette oeuvre ouvertement fictionnelle, un plaisir fantasque se dégage de prime abord dans le développement d'une logique absurde : le vent se lève, et voilà Icare, le personnage principal, s'envolant du manuscrit d'un romancier, Hubert Lubert, pour explorer le Paris de la Belle époque. De même, si l'extrême exactitude des chiffres se manifeste à tout propos, ce n'est pas dans le but de garantir une quelconque objectivité, mais bien pour marquer la charnière de deux mondes foncièrement différents : celui du réel et celui de l'imaginaire. On y retrouve la souplesse intellectuelle de Queneau déjà déployée dans les articles pseudo-scientifiques, « Quelques remarques sommaires relatives aux propriétés aérodynamiques de l'addition » et « Lorsque l'esprit » ; ici, l'auteur remet en question la loi de la gravitation universelle.
Composé essentiellement de dialogues théâtraux, l'espace romanesque se présente comme une scène imaginaire, et surtout, comme un lieu de mise en scène des réflexions métafictionnelles. Ainsi, le lecteur-spectateur est invité à regarder de loin la représentation à la fois littérale et vaudevillesque des problèmes théoriques comme « la dichotomie entre la réalité et la fiction » pirandellienne, « la liberté des personnages » sartrienne et « la nécessité de la modernité » rimbaldienne.
Enfin, dans cet excercice de réécriture, le destin d'Icare apparaît sous un aspect nouveau ; empreint d'une ambiguïté indéfinissable, son itinéraire vers le ciel est « intéressant » et certes « un peu triste », mais pas inévitablement tragique. Dans le dernier chapitre, il s'envole à nouveau avec un cerf-volant : son vol au gré de la brise sur un « losange de papier » résume parfaitement cette métafiction comme « jeux » dans tous les sens du terme.
Dans cette oeuvre ouvertement fictionnelle, un plaisir fantasque se dégage de prime abord dans le développement d'une logique absurde : le vent se lève, et voilà Icare, le personnage principal, s'envolant du manuscrit d'un romancier, Hubert Lubert, pour explorer le Paris de la Belle époque. De même, si l'extrême exactitude des chiffres se manifeste à tout propos, ce n'est pas dans le but de garantir une quelconque objectivité, mais bien pour marquer la charnière de deux mondes foncièrement différents : celui du réel et celui de l'imaginaire. On y retrouve la souplesse intellectuelle de Queneau déjà déployée dans les articles pseudo-scientifiques, « Quelques remarques sommaires relatives aux propriétés aérodynamiques de l'addition » et « Lorsque l'esprit » ; ici, l'auteur remet en question la loi de la gravitation universelle.
Composé essentiellement de dialogues théâtraux, l'espace romanesque se présente comme une scène imaginaire, et surtout, comme un lieu de mise en scène des réflexions métafictionnelles. Ainsi, le lecteur-spectateur est invité à regarder de loin la représentation à la fois littérale et vaudevillesque des problèmes théoriques comme « la dichotomie entre la réalité et la fiction » pirandellienne, « la liberté des personnages » sartrienne et « la nécessité de la modernité » rimbaldienne.
Enfin, dans cet excercice de réécriture, le destin d'Icare apparaît sous un aspect nouveau ; empreint d'une ambiguïté indéfinissable, son itinéraire vers le ciel est « intéressant » et certes « un peu triste », mais pas inévitablement tragique. Dans le dernier chapitre, il s'envole à nouveau avec un cerf-volant : son vol au gré de la brise sur un « losange de papier » résume parfaitement cette métafiction comme « jeux » dans tous les sens du terme.
About This Article
Other Article